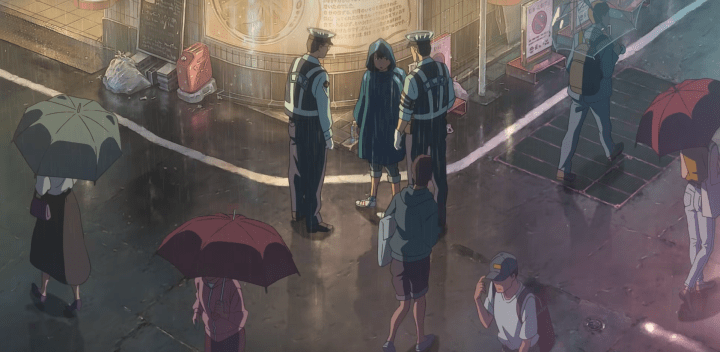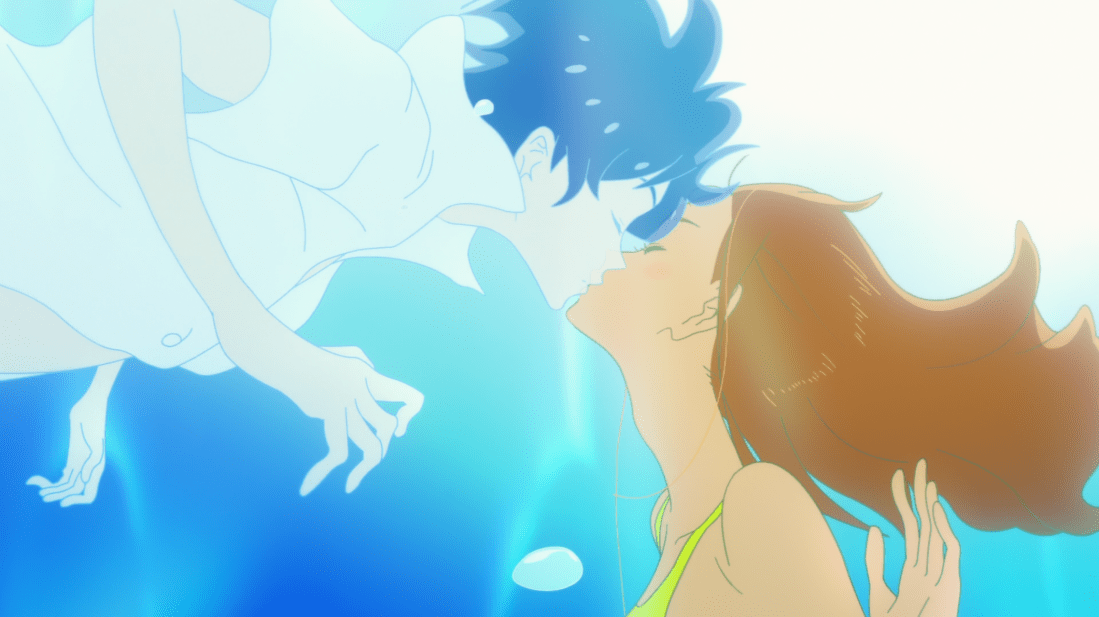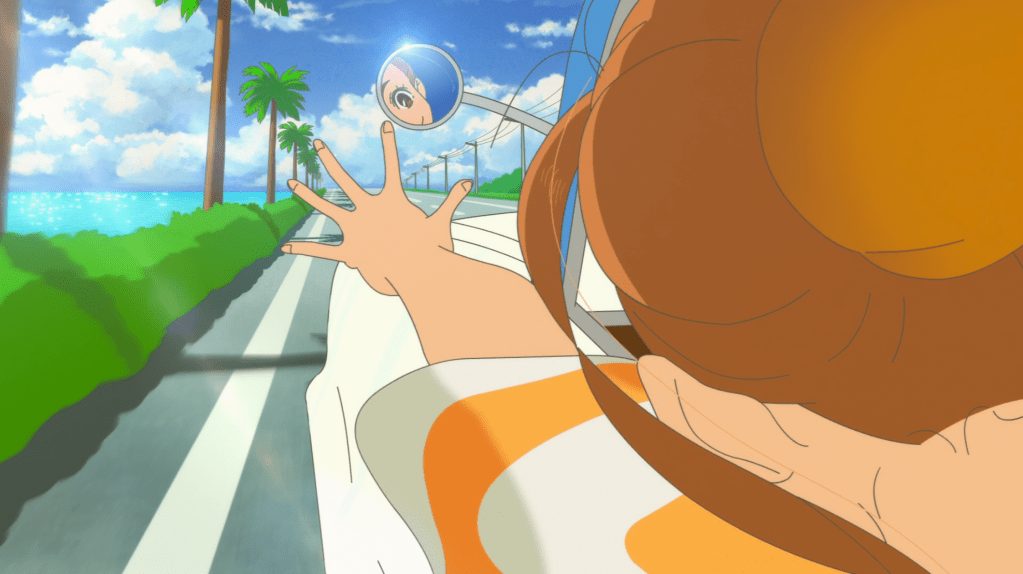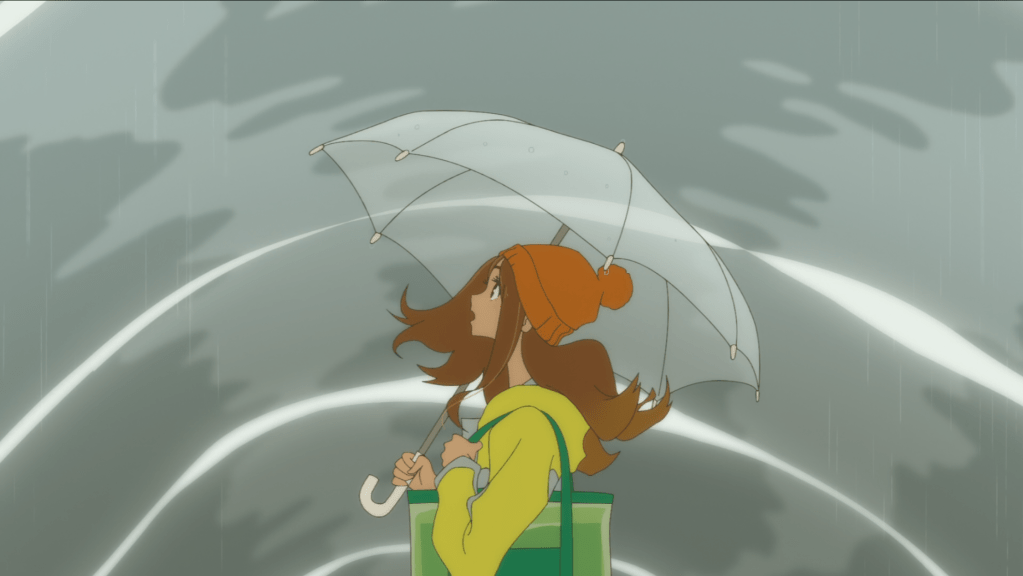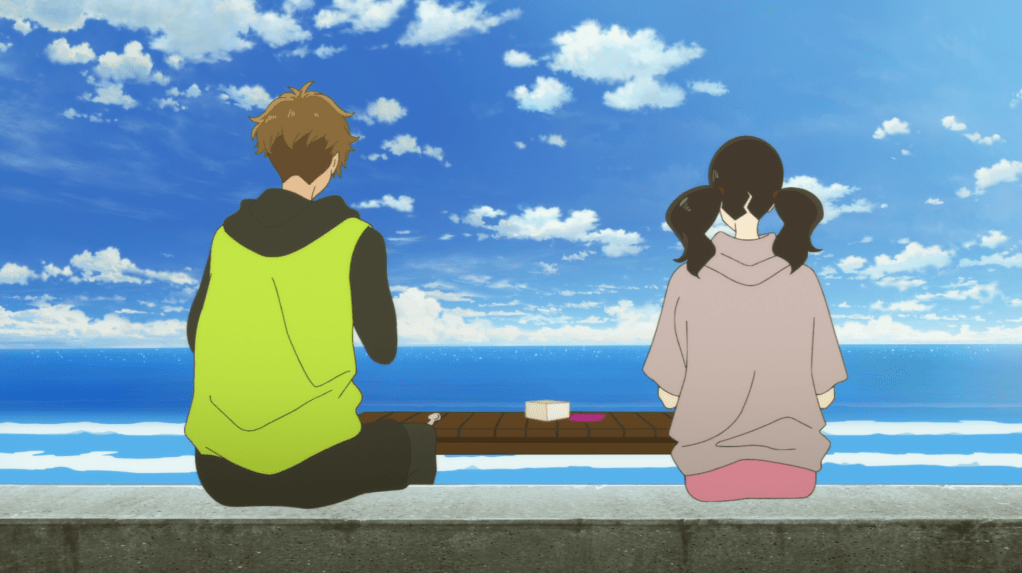On ne présente plus David Simon et l’empreinte qu’il a laissée dans l’univers de la télévision. L’ex-journaliste a contribué à redéfinir les codes du petit écran grâce à The Wire, véritable étude de société déguisée en série télévisée dont les qualités sont unanimement louées. Contrairement toutefois à certains de ses contemporains (David Chase ou Shawn Ryan, respectivement créateurs des Soprano et de The Shield), Simon n’a jamais entendu se limiter à sa seule pièce maîtresse, aussi emblématique soit-elle, et a maintenu un flot de production quasi-ininterrompu depuis près de 20 ans.
Son oeuvre, toujours placée sous la houlette du géant du câble américain HBO, comporte plusieurs mini-séries (Generation Kill, Show Me a Hero ou bien The Plot Against America diffusée cette année) mais aussi The Deuce, imposante fresque sur l’émergence de la pornographie dans les années 70, dont Critique Collatérale a récemment chroniqué la troisième et ultime saison, et également placée à la quatrième place de notre Top des séries de la décennie. Pour David Simon, le plus gros défi aura sans doute été de dépasser l’aura de The Wire, défi que le créateur américain aura relevé avec brio lors de la diffusion de sa série-fleuve suivante : Treme (2010-2013).

Associé à son collaborateur de longue date Eric Overmyer, Simon a pour l’occasion choisi de quitter les rues de Baltimore pour celles, en apparence plus colorées, de la Nouvelle-Orléans, Treme étant le nom de l’un des quartiers les plus anciens et culturellement essentiels de la ville. La série prend place quelques mois après le passage de l’ouragan Katrina en août 2005, qui ravagea la ville en causant de terribles inondations. Ce postulat de départ laissait présager d’une oeuvre-catastrophe à mille lieues de l’approche traditionnellement anti-spectaculaire de David Simon. Ç’aurait été sous-estimer le créateur, dont l’intérêt ici ne se situe clairement pas dans la dépiction du cataclysme en lui-même mais bien dans son après : la reconstruction de la ville et de l’existence de ses habitants en déroute, et la manière dont le visage de la Nouvelle-Orléans se retrouvera changé à jamais des suites de la tourmente.
Comme à son habitude, Simon aborde son sujet par le prisme d’une multitude de points de vue, la plupart des personnages principaux étant de simples citoyens. “DJ” Davis McAlary (Steve Zahn), la tenancière de bar LaDonna Williams (Khandi Alexander), l’avocate Toni Bernette (Melissa Leo)… Autant de personnalités dont les destins sont entremêlés par une narration chorale typiquement simonienne. Le showrunner s’est également adjoint les services de l’inégalable John Goodman dans le rôle du professeur Cray Bernette, ainsi que de plusieurs vétérans de The Wire, dont les plus reconnaissables sont Wendell Pierce (le tromboniste Antoine Batiste) et Clarke Peters (le “chef Indien” Albert Lambreaux).

Le procédé est similaire à celui de The Wire et, plus tard, de The Deuce : chacun de ces personnages vit son propre cheminement aux enjeux étalés sur l’ensemble des quatre saisons de la série. Parfois, plusieurs protagonistes sont amenés à se rencontrer, que ce soit lors de brèves occasions ou pour voir leurs histoires individuelles évoluer en un tronc commun. L’agrégat des personnalités présentées dans la série finit par constituer à l’écran un véritable réseau humain dont chaque individu peut avoir une influence, même très diffuse, sur le suivant. Là repose une idée maîtresse : l’influence de l’individu sur le collectif et vice-versa. Tandis que bon nombre d’œuvres télévisuelles se livrent à des études de personnages ou de groupes, Simon conçoit sa création comme l’étude d’une société, souvent circonscrite à un lieu ou une époque bien définis.
À ce titre, Treme est probablement la série longue la plus radicale du créateur. The Wire et The Deuce prenaient comme point de départ de leurs sujets la criminalité (le trafic de drogue d’un côté et la prostitution de l’autre) et faisaient reposer quantité de leurs enjeux sur la tension parfois friable entre loi et clandestinité. The Wire se nourrissait notamment de l’héritage des séries policières tandis que The Deuce empruntait régulièrement à l’univers de la pègre, se donnant même des airs de Soprano durant les segments mettant en scène le mafieux Rudy Pipilo. Treme entend au contraire narrer les tribulations de “civils”, dont la motivation première est généralement de trouver un sens à leur existence au sein d’une ville partiellement dévastée.

L’essentiel des chroniques des habitants de la ville se conçoit comme un ensemble de tranches de vie, rythmées par les péripéties du quotidien telles que les difficultés financières, les tumultes relationnels et les ambitions personnelles. Les actions des personnages sont présentées sous un jour routinier, foncièrement répétitif, et rythmées par des running gags faisant office de leitmotiv : on pensera notamment aux amères négociations opposant Antoine Baptiste aux chauffeurs de taxis ou bien aux conflits répétés entre “DJ” Davis et le gérant de la radio locale, aboutissant généralement au renvoi puis au réengagement du premier par le second.
Les arcs de chaque personnage sont minutieusement construits à travers les quatre saisons, dont chacune joue un rôle clé dans la construction d’un propos globalisant. Comme à son habitude, Simon use du découpage saisonnier pour progressivement enrichir son matériau de base. The Wire reste bien sûr un cas d’école d’utilisation de ce procédé, chaque nouvelle saison étant consacrée à l’étude d’une nouvelle strate de la ville de Baltimore. Le procédé est moins systématique dans Treme mais demeure similaire dans son principe. Si la première saison délimite son champ d’action à une poignée de personnages plus ou moins directement affectés par le passage de l’ouragan, l’ampleur du projet se déploie progressivement à mesure que le script analyse plus en profondeur les problématiques de la criminalité, de la corruption policière ou encore de l’action des financiers et entrepreneurs tentant de s’enrichir sur les ruines de la ville.

Toutes ces constatations pourraient bien entendu s’appliquer à l’ensemble de l’oeuvre de David Simon, dont la rigueur et la constance dans la conception de ses créations télévisuelles ont indéniablement contribué à bâtir sa réputation. Ce qui distingue Treme de The Wire ou The Deuce, c’est son rapport à la culture. Le choix du cadre de la série était bien entendu loin d’être anodin. Avant d’être ravagée par les inondations en 2005, la Nouvelle-Orléans était déjà considérée comme l’un des berceaux culturels les plus foisonnants des Etats-Unis. La ville jouit d’une histoire riche, à la fois vestige d’un patrimoine colonial français et berceau de la culture afro-américaine. La cité est notamment reconnue comme le lieu de naissance du jazz et par conséquent l’un des principaux noyaux de la musique populaire du XXe siècle. Encore aujourd’hui, la Nouvelle-Orléans est réputée de par le monde pour son histoire, sa musique et ses nombreuses manifestations culturelles.
Dans un premier temps, Simon et Overmyer entendent rendre hommage à ce patrimoine. La scène d’introduction de la série donne le ton en reconstituant une “second line”, ces parades festives déambulant dans les rues de la ville où se croisent fanfares de musiciens, danseurs et simples citoyens. Les manifestations culturelles néo-orléanaises constituent une part essentielle de la narration de Treme et en ponctuent régulièrement les épisodes. Bon nombre des personnages sont d’ailleurs musiciens ou impliqués indirectement dans la scène musicale locale et l’écriture intègre dans leurs parcours personnels les étapes-clés du processus de création et de diffusion de la musique : les répétitions, les enregistrements et bien entendu les concerts.

Chaque création de David Simon adopte les conventions formelles propres à son concept et son sujet. Le public se souviendra de The Wire pour son filmage évoquant le reportage d’enquête ou de The Deuce pour sa reconstitution très cinématographique du New York nocturne des années 70 – évoquant notamment Taxi Driver – ainsi que sa reproduction des codes du film pornographique et d’exploitation. De la même manière, le spectateur retiendra avant tout de Treme ses nombreuses séquences de concerts durant lesquels les réalisateurs de la série entendent reproduire le plus fidèlement possible l’expérience vécue tant par le public que par les musiciens présents sur scène. Les caméras collent au plus près des instrumentistes, le mixage sonore met en valeur la nature captée sur le vif des prestations… Surtout, le montage de la série s’autorise à faire durer ces séquences, souvent le temps d’un morceau complet, et transcende leur statut de passage obligé pour en faire de vrais moments de suspension narrative. Le temps de ces scènes ponctuelles, la performance musicale devient le véritable sujet de la série. Le mélomane se satisfera d’ailleurs de la grande variété des genres représentés : jazz et blues évidemment, mais également funk, country, hip hop et même un soupçon de metal. L’idée étant de représenter la scène locale dans toute sa richesse.
La même logique est appliquée à d’autres traditions de la Nouvelle-Orléans et culmine lors des représentations du Mardi gras. Chaque saison consacre un épisode entier à cette manifestation culturelle d’une ampleur exceptionnelle. La série transforme ces apartés en célébration de toute une imagerie folklorique (les costumes, les défilés de chariots et la distribution de colliers) et s’attache à créer avec minutie une ambiance d’effervescence tout en jouant un rôle central dans le développement de ses personnages. Chaque protagoniste est impliqué de près ou de loin dans les festivités : leurs trajectoires y évoluent de concert, s’y entrecroisent, et y connaissent généralement un profond bouleversement. Par cette interconnexion, David Simon et Eric Overmyer soulignent à quel point les destins des habitants de la ville sont profondément attachés à la Nouvelle-Orléans et sa culture.

Car les créateurs de Treme ne limitent pas leur sujet à un simple encensement du foisonnement culturel néo-orléanais. La paire aspire au contraire à problématiser, tout au long de l’oeuvre, le rapport complexe qu’entretient la population avec son glorieux patrimoine. Ce rapport est défini selon une double corrélation : une première entre passé et présent et une seconde entre intérieur et extérieur. Le passé est régulièrement convoqué lorsque les habitants évoquent ce qui fait la grandeur de leur ville : la naissance du jazz et du blues au début du XXe siècle et les différentes traditions héritées d’une histoire métissée. Cette fierté est toutefois régulièrement mise en contraste avec l’incapacité de la cité à préserver ce qui fit autrefois sa renommée. Les bâtiments historiques sont ainsi laissés à l’abandon, tandis que les manifestations musicales sont régulièrement contrariées par des conflits avec les forces de l’ordre. Lorsque s’envisage la construction d’un “jazz center” pour célébrer l’ancrage musical de la ville, le projet, à l’initiative de banquiers et entrepreneurs, se fait en contradiction totale avec l’idée essentielle que les musiques populaires dont il est question sont nées dans les rues et dans un contexte d’adversité.
La série rappelle également avec un sens des réalités fataliste que la Nouvelle-Orléans demeure la ville ayant le taux de criminalité le plus élevé aux Etats-Unis et que le passage de l’ouragan, loin d’avoir inversé cette tendance, n’a provoqué qu’une trêve dans l’escalade permanente des activités criminelles. Le constat dressé par Simon est similaire à celui qu’il mettait déjà en exergue dans The Wire : c’est la hiérarchie de la ville, la corruption qui y règne et la négligence du besoin des citoyens les moins bien lotis qui perpétue ce cycle de violence et de misère.

Le personnage de Davis McAlary est symptomatique du rapport qu’entretient la ville avec son historicité culturelle. Musicien blanc mais vivant dans le quartier populaire du Treme, il se revendique comme le porte-étendard du passé musical néo-orléanais et ambitionne, à travers son art, de transfigurer cet héritage en lui rendant la verve populaire et revendicatrice qui fut autrefois la sienne. Mais face à l’insuccès de ses différentes entreprises artistiques, McAlary est systématiquement contraint de revenir à son rôle de DJ de radio locale et condamné à célébrer la musique qui fit la grandeur d’autrefois plutôt qu’à écrire celle qui forgera l’avenir.
Le rapport intérieur/extérieur traduit quant à lui avant tout une relation au territoire et à l’appartenance. Ville touristique par sa spécificité culturelle, la Nouvelle-Orléans est présentée comme conservatrice et protectrice d’un folklore souvent incompris par les étrangers. Simon et Overmyer prennent pour cas d’école l’existence des “Indiens de mardi gras”. Ces rituels folkloriques, nés d’une complicité ancestrale entre deux minorités opprimées (les Natifs américains et les Noirs d’Afrique), sont pratiqués par des citoyens organisés en tribus et au fonctionnement fondé sur la répétition des traditions et la transmission rituelle. Les parades des “Indiens” sont perçues à travers la série comme l’expression la plus pure du folklore néo-orléanais : leur pratique est détachée de toute volonté d’attirer un public étranger ou d’agir comme une vitrine de la ville, mais ne perdure que par sa propre nécessité de continuer à exister, de perpétuer une coutume en vigueur depuis des générations.

Les citoyens de la ville sont quant à eux soumis à une perpétuelle injonction contradictoire. La vie quotidienne à la Nouvelle-Orléans est difficile, entre des conditions d’emploi précaires, les risques liés à la criminalité élevée et l’ingérence des autorités. Bon nombre des personnages de Treme se mettent à rêver d’un ailleurs serein et dégagé de toute forme d’adversité. Pourtant, tous les personnages qui concrétisent ce fantasme sont irrémédiablement tentés de revenir en arrière, comme si le rapport à leur ville d’origine était une dépendance qui prévalait au besoin de mener une existence moins tourmentée.
Cette attirance presque irrationnelle est illustrée dès les premières séquences de la série par le retour du chef Indien Albert Lambreaux sur ses terres natales, le vieil homme préférant honorer son devoir de passeur de tradition et vivre dans des conditions misérables en rénovant sa maison inondée plutôt que de vivre avec ses enfants, loin des tracas liés à la cité dévastée. Son fils, Delmond, semble incarner à la perfection ce tiraillement entre intérieur et extérieur. Célèbre trompettiste, il est promis à une fastueuse carrière de jazzman moderne à New York mais son attachement à un père bourru et entêté le voit alterner entre les deux villes dans un mouvement de va-et-vient constant, sans arriver à pleinement satisfaire l’une des deux tendances. La nécessité pour le musicien de se reconnecter à son père tout en s’émancipant artistiquement de son influence peut être vue comme une illustration de la dichotomie qui définit le rapport complexe de la population à son territoire.

À travers toutes ces réflexions spécifiques au legs culturel de la Nouvelle-Orléans, Simon et Overmyer interrogent plus largement la notion de culture. Qu’est-ce qui définit une culture et l’attachement qu’on lui porte ? Quel est le sens de la préservation des traditions ? Comment sommes-nous définis par notre appartenance à un territoire et à un folklore ? Autant de questions auxquelles la paire se refuse à apporter une réponse définitive : la multiplicité des chemins empruntés et des destinations atteintes par leurs nombreux personnages semble embrasser la globalité des possibilités de l’existence, définies à la fois par le choix et la contrainte.
Si Treme n’a pas acquis au fil des années le même statut que l’oeuvre culte de David Simon, elle n’en demeure pas moins tout aussi essentielle. Le corpus du vétéran du petit écran s’évertue à interroger, série après série, le fonctionnement de la société humaine dans toute sa richesse et à travers de multiples problématiques (l’organisation hiérarchique, l’histoire et, dans le cas qui nous intéresse, la culture). Par les questions passionnantes qu’elle soulève, sa galerie de personnages d’une richesse rarement égalée et le portrait inédit qu’elle livre d’un berceau culturel unique, Treme s’impose comme une oeuvre phare de la télévision, à découvrir de toute urgence.