Organisé chaque année à Bruxelles, le festival du film d’animation ANIMA est la célébration régulière d’un médium dont la richesse reste souvent ignorée du grand public. Cette année, le festival était exceptionnellement organisé en ligne du 12 au 21 février et offrait aux participants la possibilité de regarder près de 268 films d’horizons et de genres variés, couvrant l’ensemble des techniques employées au sein du cinéma animé. Afin de célébrer cette initiative, Critique Collatérale a choisi de chroniquer l’ensemble des 12 long-métrages de la sélection.

Le cinéma coréen était à l’honneur du festival avec pas moins de trois long-métrages présentés. Parmi ceux-ci, Motel Rose de Yeo Eun-a et Beauty Water de Cho Kyung-hun partagent d’étranges similitudes. Les deux films traitent à leur manière de la thématique de l’image et entreprennent de déconstruire le culte de la beauté unique. Le premier privilégie une approche minimaliste proche d’un huis-clos puisqu’il enferme ses personnages principaux, deux jeunes étudiantes plongeant dans le milieu de la prostitution, au sein d’un décor central : le fameux bordel qui donne son titre au film. La réalisatrice y développe une atmosphère particulièrement anxiogène, accentuée par la lenteur mortifère du métrage et servie par un travail de cadrage et de colorisation qui sublime une animation aux mouvements réduits. Motel Rose emprunte énormément au Perfect Blue de Satoshi Kon, qu’il s’agisse de son traitement du voyeurisme, de l’omniprésence de la figure du double ou de la manière dont il subvertit l’image de la pop star innocente. Et si le film de Yeo Eun-a ne surprend guère au fil de son développement narratif, la réalisatrice a l’immense mérite d’assumer jusqu’au bout la radicalité et la violence de son propos en ne laissant aucun répit au spectateur.

Beauty Water demande quant à lui un relatif temps d’adaptation tant son style d’animation, mélangeant 3D en “cel-shading” et 2D traditionnelle, laisse perplexe. Ce type d’images de synthèse se détache en effet difficilement d’un rendu amateur et semble en perpétuel décalage avec le ton macabre du film. Il serait toutefois dommage de se laisser rebuter par la plastique d’un film qui a beaucoup à offrir. Cho Kyung-hun choisit de lorgner du côté du pur film de genre nimbé de satire sociétale. Le culte de l’apparence est sauvagement démantelé par le recours au body horror, le réalisateur mettant en scène une société où l’embellissement passe littéralement par la cannibalisation du corps d’autrui. Beauty Water regorge d’images dérangeantes, savamment distillées au cours d’une intrigue jusqu’auboutiste et d’un cynisme délicieusement cruel.

Troisième film coréen du programme, The Shaman Sorceress s’inscrit quant à lui dans une veine radicalement différente. Le film de Jaehoon An relate la relation de plus en plus distante entre une mère chamane adepte de rites coréens ancestraux et un fils converti au christianisme. Fable tragique sur le choc des cultures et la perte progressive des traditions, The Shaman Sorceress se construit comme un curieux mélange entre une narration contée sans temps morts et des passages chantés étonnamment mélodramatiques. On retiendra avant tout le film pour son graphisme conjuguant des personnages aux traits épurés avec des décors picturaux riches en détail, ainsi que pour ses subjugantes scènes de transe chamanique.
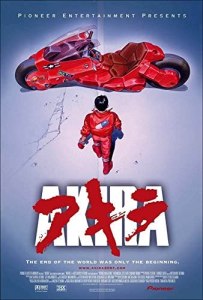
Du côté du voisin japonais, terre providentielle de l’animation, la sélection était variée quoique inégale. On ne présente bien entendu plus le Akira de Katsuhiro Otomo. Le film de 1988 est peut-être le long-métrage le plus important de l’histoire de la japanimation, tant par ses prouesses techniques que par la manière dont il fit voler en éclat les limites de son médium. Akira ouvrit la voie à un courant plus radical qui ne se refusait aucun excès tant dans l’ambition des sujets traités que dans la manière de les représenter et il est difficile d’imaginer le visage qu’aurait l’animation nipponne aujourd’hui sans le geste d’Otomo. Mais, au-delà de son importance historique, le film continue de captiver. En premier lieu, par ses questionnements sur l’avenir d’un pays traumatisé par le nucléaire, incarnés à travers le portrait d’une adolescence en déroute. Ensuite, par la seule puissance de son imagerie, alliant visions post-apocalyptiques d’un futur décadent et transformations corporelles monstrueuses rendues viscérales par une animation d’une ampleur sans précédent. Splendidement illustré par la BO de Geinoh Yamashirogumi, Akira fait partie de ces classiques immaculés malgré le poids des années et qu’il est impératif de (re)découvrir.

7 Days war est probablement le plus anecdotique des long-métrages proposés par le festival. Malgré des promesses thématiques intéressantes – c’est l’un des rares représentants de la japanimation à aborder la question de l’immigration illégale – le film de Yuta Murano se complait dans une série de poncifs propres à l’animation nipponne contemporaine. Teen movie standard aux personnages archétypaux et aux rebondissements attendus, 7 Days war ne peut même pas compter sur sa patte graphique, l’animation étant tout juste d’un niveau télévisuel moyen. L’œuvre conserve malgré tout un relatif capital sympathie grâce à son ton enjoué et sa réinterprétation de Maman j’ai raté l’avion sur fond de décor d’usine désaffectée.

Le troisième film nippon du festival était la dernière adaptation en date du manga Lupin III, sous-titrée The First. Ultime incarnation des aventures du célèbre voleur à avoir été chapeautée par son créateur Monkey Punch avant son décès, le métrage est également le premier de la saga à avoir été réalisé en 3D. Malheureusement, la tentative de The First de rafraîchir les codes de la saga tombe à plat. Elle n’est d’ailleurs pas avantagée par son scénario anecdotique qui recycle timidement les poncifs de la saga tout en pillant tout le patrimoine du film d’aventures, Indiana Jones en tête. La comparaison avec un autre film de Steven Spielberg, Tintin, rappelle quant à elle l’importance de penser l’animation 3D en terme de mises en scène, au-delà de tout accomplissement technique.
Enfin, l’organisation du festival a ajouté in extremis un quatrième film japonais à la sélection : On-Gaku: Our Sound, qui n’est ni plus ni moins que le gagnant du meilleur prix du long-métrage du festival. Nous n’avons pas eu l’occasion de nous pencher en détail sur cette proposition inédite pour la sortie de cet article mais elle fera néanmoins l’objet d’une critique approfondie dans les lignes de Critique Collatérale très prochainement.

Le festival permettait également de découvrir deux représentants du genre du documentaire d’animation. Up We Soar, de la réalisatrice chinoise Yan Ma, se révèle être un témoignage essentiel de l’histoire récente de son pays puisqu’il relate la persécution du mouvement spirituel Falun Gong à la fin des années 90. Le film lève le voile sur un énième épisode d’une nation tristement connue pour ses violentes répressions et son culte de la pensée unique, tout en mettant l’accent sur l’importance de la résilience à travers l’histoire d’une mère et d’une fille séparées lors de ces évènements. L’animation en images de synthèses n’est ici employée qu’à des fins d’illustration, donnant vie aux témoignages des deux intervenantes croisés dans un récit somme toute assez unidimensionnel.
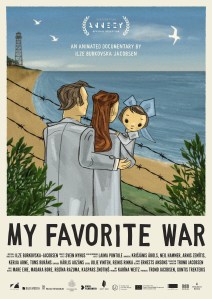
Conçu selon un procédé similaire, My Favorite War d’Ilze Burkovska Jacobsen relate l’expérience de la réalisatrice ayant grandi en Lettonie durant la Guerre Froide. Comme dans Up We Soar, l’animation a pour but premier de donner une forme sensible au récit de la cinéaste. Jacobsen se distingue toutefois par une utilisation plus créative du médium, entre un trait dessiné original et des élans fantaisistes qui contrastent agréablement avec le sujet très dur du long-métrage. Son histoire, nourrie par sa vocation journalistique, se conçoit avant tout comme un appel à la prise de position et l’importance de la liberté de penser et s’exprimer face à un régime totalitaire, bien au-delà de la seule histoire de l’Europe soviétique.

Autre long-métrage abordant frontalement le sujet difficile du totalitarisme européen du XXe siècle, Josep relate une partie de l’existence du dessinateur espagnol Josep Bartoli contraint de fuir l’Espagne de Franco en 1939. Transpirant l’influence de la bande dessinée jusque dans ses traits (et pour cause : le réalisateur Aurel est avant tout auteur de BD), le film se distingue par son parti pris visuel échafaudé autour de sa structure en flashbacks. En effet, alors que les scènes “au présent” sont animées de manière traditionnelle, les séquences du passé abandonnent toute notion de mouvement fluide et continu pour une succession d’images quasiment fixes. Ce choix renforce la filiation du récit avec son sujet, Bartoli étant dessinateur, mais amorce aussi une réflexion sur la notion de mémoire. La pratique y est vue à la fois comme une thérapie face à la douleur du souvenir mais aussi comme un déni de la substance du traumatisme. À la fois riche, touchant et instructif, Josep est l’un des coups de cœur de Critique Collatérale sur cette sélection.

En termes d’animation, le Vieux Continent compense son manque de moyens et de démesure au regard de ses équivalents américains et nippons par une inventivité et une liberté de ton à toute épreuve. Kill It and leave this town, réalisé par le polonais Mariusz Wilczyński, est une proposition de cinéma des plus singulières. Très austère et minimaliste, le film se construit avant tout comme un fil d’idées et d’ambiances, ponctué d’images interpellantes et de métaphores visuelles sans appel. L’imagerie très sombre de l’œuvre de Wilczyński et sa tonalité constamment crue peuvent rendre l’expérience pesante mais sont toutefois contrebalancés par un segment final libérateur, sommet de poésie onirique soutenu par la superbe musique du groupe polonais Breakout.

Expérience tout aussi déroutante, The Nose or the conspiracy of Mavericks se distingue autant par son contenu que par sa genèse. En effet, ce film russe, adaptation conjointe du Nez de Nicolas Gogol et de sa transposition en opéra par Dmitri Chostakovitch, aura connu une gestation de près de cinquante ans avant que son réalisateur, Andreï Khrjanovski, ne parvienne à le mettre sur pied. Le produit final est un ovni d’animation, à la fois opéra animé, semi-documentaire sur la condition artistique sous Staline et multi-mise en abyme abordant le processus créatif. La narration anti-conventionnelle du film et la profusion des formes d’animation qu’il met à profit ont de quoi dérouter. Toutefois, la nature expérimentale de l’essai de Khrjanovski dissimule un embryon réflexif sur l’éternelle tension entre art et politique, et la manière dont les personnalités créatrices excentriques sont absorbées, consommées et digérées par l’Histoire. Une curiosité à découvrir, quoiqu’un peu alourdie par un dernier tiers sombrant dans le didactisme pur.

Enfin, le moyen-métrage Topp 3 s’impose définitivement comme la bouffée d’air frais du festival. Ce film suédois réalisé par Sofie Edvardsson narre l’idylle de deux jeunes hommes alors que leurs années de collège s’achèvent et que la vie s’offre à eux. Le métrage prend l’apparence d’une comédie portée à la fois par la maladresse attendrissante de son personnage principal et son animation simple et colorée usant et abusant d’apartés visuels. Mais au-delà de son ludisme, Topp 3 est avant tout un beau film d’amour, qui livre une vision douce-amère, ni idéalisée ni désenchantée, du concept de romance. La relation d’Anton et David est d’autant plus touchante qu’elle s’incarne à l’écran par une succession de petits gestes ou jeux d’expressions, plutôt que via de grandes envolées verbeuses. Une proposition pétillante qui contraste avec une série d’œuvres aux thématiques nettement plus graves.
Si nous avons choisi de nous concentrer sur les long-métrages, il serait malavisé de complètement ignorer l’impressionnante sélection de courts offerts par le festival, dont nous n’avons malheureusement pu découvrir qu’une infime partie. Parmi les coups de cœur de Critique Collatérale, on trouve donc Rebooted, hommage à la fois décalé et attendrissant aux effets spéciaux de cinéma, le visuellement splendide Trona Pinnacles ou encore Navozande, le musicien, bouleversant concentré de poésie tragique orientale. Le festival était également l’occasion de (re)découvrir le Père et fille de Michael Dudok De Wit, merveille de narration par l’image qui préfigure son chef-d’œuvre : La Tortue Rouge. Il est difficile de rendre hommage à une palette de créations si large, couvrant autant de registres qu’il en existe au sein du médium de l’animation : propositions humoristiques, contemplatives, abstraites, en stop-motion, animées par ordinateur ou en dessin traditionnel… Un rappel essentiel que le format du court est définitivement le terrain d’expérimentation idéal du médium, au sein duquel germent les idées les plus audacieuses.
Cette édition 2021 d’ANIMA se sera révélée particulièrement riche. Couvrant essentiellement les cinémas asiatique et européen, la sélection de long-métrages fit montre d’une certaine nécessité d’engagement en offrant des œuvres politiques, relevant du devoir de mémoire ou bien dénonçant les dérives de nos sociétés contemporaines. Au sein d’un monde particulièrement en crise, le cinéma d’animation continue de trouver de nouvelles manières de représenter les grandes questions qui taraudent le genre humain, tel un miroir déformant au reflet indécis. C’est ainsi que Critique Collatérale clôture cette mouture online du festival, en espérant pouvoir continuer de célébrer toutes les formes du film animé en salles dès l’année prochaine.






